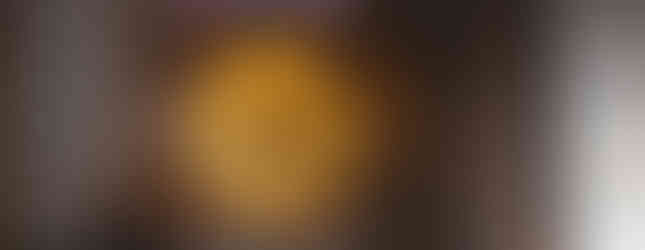Pèlerinage de l’Année Jubilaire Visitation à Notre Dame de Paris
- Michel Teheux

- 27 oct. 2025
- 17 min de lecture
Dernière mise à jour : 30 oct. 2025

En dialogue, histoire et spiritualité
6 journées d’une cathédrale
Pierre de fondation, printemps 1163
Ils se sont faits bâtisseurs. De siècle en siècle.
Parfois ils ont démoli ce dont ils avaient hérité pour reconstruire et être de leur temps. Ils ont réparé pour que l’héritage soit transmis dignement.
Ils se sont fait bâtisseurs de leur maison.

Nous sommes nés dans cette maison et l’église et d’abord pour nous un berceau de pierres. Nous avons besoin pour grandir paisiblement de la lumière filtrée au travers des vitraux pour ne pas être éblouis et ne plus rien voir : ils nous ont éclairés au travers du visage de nos ancêtres qui nous racontaient notre histoire. Ce berceau de pierres nous abritait lorsque les tempêtes nous faisaient vaciller dans nos engagements.
Nous avons aimé palper de nos mains frêles la rugosité du granit qui nous paraissait protection et solidité. Nous avons aimé explorer les recoins de notre maison : ses combles nous ont transmis une mémoire tout en éveillant notre imagination.
La maison où nous avons été enfantés est devenue aussi notre école car nous avons appris à y grandir. Nous avons trouvé là de quoi nous nourrir, nous y avons appris à marcher, à parler, à prendre notre place. Nous avons trouvé dans l’église qui est la nôtre un lieu de pédagogie, de promotion, ce qui nous a mis sur pieds et nous a fait tenir debout comme croyants. Car nous n’existerions pas comme chrétiens s’il n’y avait eu à un moment de notre histoire cette maison commune pour nous engendrer et nous éduquer.
Certes il peut y avoir des malformations de la naissance et trop souvent de graves malfaçons de l’éducation, et combien d’entre les enfants de la maison sont demeurés difformes ou diminués. Mais nous avons cru possible de rester « chez nous » plutôt que de prendre la porte ou de prêcher hors les murs et choisi de transmettre à notre tour et à notre façon ce que nous avions appris dans cette école.
La maison est notre maison.
Sans grilles et sans guichets. Nous la rêvons avec en guide de murs des fenêtres qui regardent et des portes qui reçoivent.
Notre maison se voudrait un havre, hospice, hôtel-Dieu.
Nous voudrions pouvoir y accueillir tous nos amis. Sera-t-elle celle où tous pourront se sentir chez eux ? Il ne suffit pas qu’ils puissent être hébergés sans rien apporter. Notre maison serait plutôt un abri de pèlerin, une auberge espagnole où chacun apporte ce qu’il a, ce qu’il est.
Notre maison n’a pas besoin d’être immense, il faut seulement qu’elle puisse toujours s’agrandir. On a pu bâtir une chapelle gothique au flanc d’une nef romane, et quand cela a été nécessaire une église nouvelle s’est construite sur les fondations de l’ancienne. Notre maison est ainsi faite de cellules qui s’encastrent comme les éléments d’un jeu de construction.
Notre maison est surtout toujours en chantier : il y a toujours des échafaudages, on ravale toujours une façade, on soutient une voûte, on bâtit une aile.
Les fondations sont souterraines sans doute mais elles ont permis de construire l’édifice. Il nous arrive de creuser ou de faire des sondages pour les retrouver mais c’est pour découvrir, émerveillés, ce qui s’est bâti au-dessus.
Une maison qui n’a pas de murs parce qu’elle est bâtie de pierres vivantes.
Nous devenons peu à peu à nous-mêmes notre demeure : Ekklesia… Maison d’assemblée.
Ecrin de la couronne d’épines, 19 août 1239
Malgré tout

À Jérusalem, ce vendredi-là, l’heure était au silence.
La terre elle-même s’était couverte d’une chape de plomb, celle de l’interrogation et du scandale impuissant.
Ce vendredi-là, le prophète victime de la violence des parti-pris, de l’injustice insoutenable des faux procès et des jugements menteurs, le prophète assassiné questionnait : « Pourquoi m’as-tu abandonné » ? faisant écho à nos interrogations devant trop de guerres, trop d’injustices, trop de violences, trop de mal-être, trop de détresses et de désespérances, ces interrogations douloureuses qui résumait pour nous le psalmiste « L’homme, qui est-ce que l’homme » ?
Mais au cri douloureux il ajoutait aussi, dans le même temps.
« Ils ne savent pas ce qu’ils font » ! Rupture du cercle infernal de la violence appelant la violence, la désespérance appelant la révolte, l’injustice la revanche.
« Ils ne savent pas ce qu’ils font » ! un cri de foi douloureuse.
Devant la couronne du crucifié nous conjuguerons à nos « pourquoi questionnant et scandalisés » le credo du Golgotha « Ils ne savent ce qu’ils font ».
S’ils savaient qu’ils ont tout faux… S’ils savaient que la foi nous rend libres et ne nous enferme jamais dans le ghetto d’une pensée unique… S’ils savaient que l’amour, la paix et l’espérance sont les fruits de ce dont et qu’ils peuvent même grandir sur les décombres d’une vie annihilée… S’ils savaient qu’aimer est une décision et que celle-ci se nourrit de proximité d’authenticité, d’attention et d’écoute… mais aussi de pardon… S’ils savaient qu’on ne peut donner un sens à sa vie contre les autres mais avec eux… S’ils savaient que la violence est un aveu de faiblesse, qu’elle enfante le chaos, qu’elle terrifie mais n’a jamais le dernier mot.
S’ils savaient…
Devant la couronne auréolée de lumière par son écrin précieux confrontant à nos «pourquoi » ? le credo de l’amour qui aime encore, du pardon qui relève, de l’espérance qui remet debout, nous anticiperons, ce cela même, l’annonce du matin de Pâques : « Il est vivant » !
Devant la couronne de gloire nous recevrons notre vocation.
« Il est vivant, Premier-Né, Ainé d’une multitude de frères » !
« Vous êtes des fils de la lumière commentera l’apôtre Paul, vivez donc en fils de lumière ».

La résurrection que nous confessons n’est pas d’abord la conclusion d’une démonstration ou d’un raisonnement : elle est l’objet d’un témoignage.
Il n’y a pas de « Vivant » en effet sans que la vie qui préside à l’histoire du monde, sa vie, ne soit la source où se nourrit notre vie. Il n’y a pas de foi en la résurrection sans le témoignage de l’Église : le seul signe de la résurrection, ce sont des hommes et des femmes vivants, transfigurés par l’annonce incroyable de ce Matin-là.
Pâques n’existe que dans le Passage. Vie qui grandit chaque fois que nous essayons de vivre. Malgré tout, tant bien que mal.
Libération qui s’affirme et s’affermit chaque fois que nous marchons. Debout. En nous relevant. En titubant. En nous traînant, qu’importe.
Libération qui ne se manifeste que lorsque nous relevons la tête.
Malgré tout, tant bien que mal.
Pâques n’existe que lorsque, par la grâce de la Lumière que nous avons accueillie, nous sommes des passeurs de vie, de libération. Passeurs de Lumière.
Non pas que nous prétendions que tout est clair en notre vie.
Non pas que nous prétendions que tout est évident en notre foi.
La vie que nous construisons est malmenée, la libération dont nous sommes les artisans est marquée par tant de chutes et de retours en arrière, d’impasses et de chemins de traverse.
La lumière que nous souhaiterions transfigurante a tant de mal à lutter contre les désespérances et parfois même le désespoir.
Pâques n’existe que dans l’humilité du témoignage de deux ou trois femmes et celui de quelques hommes ne sachant comment parler, dans celle du témoignage d’une longue lignée qui essaie depuis plus de vingt siècles de vivre maladroitement la révolution du ce Matin-là.
Car si la couronne est auréolée de lumière, elle garde dans cette aura précieuse, les cicatrices du drame épouvantable de ce vendredi-là : c’est bien une couronne d’épines que nous vénérons.
Le vœu de Louis XIII, Consécration à la Pieta,
10 fevrier 1638
Maternité

Douloureuse, elle émeut.
Émouvante… Mère recevant le corps sans vie de celui à qui elle a donné la vie.
Mater Dolorosa. Pieta.
En pleurs. Notre sœur. Comme nous elle se dit sans doute : est-il donc possible que la vie humaine ne soit que cela, une courte histoire qui se termine toujours par la mort. la vie n’est-elle toujours qu’une défaite acceptée ou, en tous les cas, imposée ?
Est-il possible que l’amour soit toujours définitivement anéanti et vaincu ?
Et que restera-t-il de ce que nous avons laborieusement construit ; sans doute, au mieux, quelques souvenirs jaunis que le temps effacera de plus en plus ?
La vie serait-elle une absurdité inacceptable ?
Elle recevait le corps désarticulé pour rendre l’inacceptable un peu plus tolérable. Pour retenir u moment encore ce qui, pourtant, lui était déjà arraché.
Douloureuse mais offrante.
Les bras levés comme le prêtre commençant la prière eucharistique.
Elle est la célébrante du divin sacrifice plus que la mère éplorée.
Majestueuse. Victorieuses en quelque sorte. En action de grâce. Vierge eucharistique.
Elle reçoit sur ses genoux les corps du Bien-Aimé, comme le reposoir du Saint Sacrement du Fils offert.
Mais déjà, comme en extase, elle voit l’Invisible du visible. Elle ne se complait pas dans une douleur indicible, elle proclame l’indicible mystère du corps offert en offrande.
La Pieta devient voyante. Etonnée elle voit déjà la pierre du tombeau qui va être le reposoir du Maitre de la vie roulée, ouverte. Comme une béance. Comme un possible à découvrir, à recevoir.
Ce qu’elle reçoit comme testament et relique pourraient être parole de vie pour faire vivre. Sur ses lèvres d’adorante et de voyante surgit le mot qui transfigure le gibet d’infamie en croix de victoire, fanal qui polarise le regard et oriente dès le seuil franchi de la cathédrale, étendard d’or victorieux même à l’heure du désastre dressé sur les décombres fumants des voûtes écroulées.
« Il est vivant »
La mère explorée devenue voyante, Marie de douleurs transfigurée devient missionnaire. « Ne cherchez pas le vivant parmi les morts : il n’est plus ici ».
Au lieu d’enserrer, maternelle, le corps qu’elle a enfanté, elle ouvre largement les bras et comme l’ange du dimanche matin dans le jardin du tombeau ouvert elle avertit « allez dire, il vous précède ».
Chef d’oeuvre de l’art français, don d’un roi reconnaissant pour consacrer son peuple, comme un prédicateur dans une chaîne de cathédrale la Pieta lève les bras au ciel « Allez dire » et nous recevons d’elle l’appel de notre vocation d’être artisans de Pâques, artisans d’espérance « Ne cherchez plus parmi les morts » !
Elle, elle délaisse le corps sans vie au lieu de le materner pour nous guider vers le fanal d’une croix glorieuse, pour nous consacrer passeurs de vie : nous avons devoir de réenchanter notre temps pour que chaque jour soit annonce de Pâques.
Sacre de Napoléon
2 décembre 1804
Ordonnés au service public

Son sacre l’ordonnait-il au service public ou serait-il son ambition ?
Le « politique » sera-t-il le service des intérêts de la cité ?
Les utopies en ont pris un coup !
Celles d’un monde universel, ouvert, pluriel. Celles d’un monde solidaire pour que la terre tourne rond. Celles des sociétés fondées sur la tolérance, le vivre ensemble, l’interdépendance.
Ces utopies sont blessées gravement par des programmes odieux stigmatisant l’étranger, magnifiant le repli d’un affuble des qualités du cocooning, les sectarismes identitaires pudiquement voilés sous les titres nobles de patrie, mais qui séduisent les électeurs aveuglés ou déboussolés et conduisent au pouvoir de nouveaux gouvernants dans nombre d’états proches. Les utopies humanistes sont blessées gravement et, malheureusement, peut-être de plus en plus. Les dérives sociétaires et les déconvenues politiciennes de démocraties frileuses auront-elles raison de nos valeurs et de nos choix ?
Le débat public capitalisera-t-il sur une évolution délétère ou de l’odieux ?
Légitimera-t-il une voie pavée de vulgarité, de bêtises et de haine ou élèvera-t-il au double sens d’éduquer et de faire prendre de la hauteur ! le lien social se construira-t-il par-delà les identités estimées perdues et les acquis prétendument intouchables ?
Quel récit fondateur indiquera quelle voie nous cherchons à suivre ?
Il s’agit bien de fédérer une collectivité en tant qu’entité morale se reconnaissant en certains principes et en les tenant pour contraignants.
Ce récit fondateur, s’il est de la responsabilité d’être « élevé » par ceux à qui est confiée la charge publique, est appelé à être une histoire commune. Les valeurs ne sont fondatrices que nourries par la reconnaissance de tous. Elles polarisent un être-ensemble parce que tous s’accordent à elles : elles ont la force du lien qu’elles instaurent.

À l’heure de la tentation de revendications unilatérales des droits acquis lorsque nos sociétés de consommation connaissent hésitations et soubresauts économiques, à l’heure de la tentation de replis frileux et prétendument identitaires lorsque les solidarités sociales connaissent le contrechoc des conséquences d’une mondialisation irréversible, il faut rappeler qu’il dépend de chacun d’être le terreau où naîtra une philosophe politique digne de l’homme, de tout homme, de tous les hommes.
Lorsque dans notre ordinaire de « Monsieur tout le monde » nous banalisons des discours stigmatisants et odieux dénonçant les exclus, les étrangers, les non-intégrés, faisant du faible un danger plutôt que l’objet de notre sollicitude, lorsque nous nous satisfaisons d’explications simplistes et ségrégationnistes liant nos soucis sociétaires à une culture, à la religion, à une classe sociale, nous devenons le terreau de politiques imbéciles autant que de dérives, pire encore, de comportements quotidiens déshumanisants.
Une société qui se reconnait et se construit dans un récit tissé de solidarité et de valeurs humaines plutôt que de compétition et de dureté, d’exclusion et de repli, aura à cœur de respecter un humanisme qui grandit et élève.
Elle s’obligera à se comporter conformément à la haute opinion qu’elle se fait d’elle-même. Non pas une hauteur faite de mépris vis-à-vis de l’autre mais, au contraire, une hauteur à la mesure de celle des valeurs qu’elle s’impose et dont elle tâche de se montrer digne. Une hauteur qui, avant tout, oblige celui qui s’en réclame.
Cette société-là est bien plus solide, bien plus résiliente que celle qui, se vivant comme une nation assiégée, se voudrait à l’abri des murailles qu’elle devrait rehausser chaque jour.
Il n’est pas dans mes intentions de me faire le porte-drapeau de quelque programme du vivre ensemble, il n’est pas de ma responsabilité de promouvoir les modalités politiques et d’imaginer les compromis sociétaires indispensables pour fonder un consensus social. Il me revient seulement de redire qu’il n’y a de possible vivre-ensemble que dans la rencontre et le lien, et que pour ceux qui ont choisi de mettre leur conduite sous le signe de l’Évangile d’un certain Jésus, c’est cette voix-là, et celle-là seule, qui est chemin de vie véritable.
Ceux qui choisiront de l’emprunter, quels que soient les modèles pluriels qu’ils proposeront pour concrétiser leur choix, devraient trouver ceux qui se réclament du prophète galiléen des partenaires convaincus et volontaires.
Un seul défi nous provoque et nous unit : nous mettre au service de l’homme.
De tous les hommes. De tout homme.
Restauration de la vieille dame,
Viollet-le-Duc, 31 mai 1864
Le temps de l’Église

Elle aurait pu être vouée à la démolition ! Contre toutes les bonnes raisons un poète a pris sa défense et un homme d’action a relevé le défi : Victor Hugo et Eugène Viollet-le-Duc ont sauvé Notre-Dame. Les murs ont été relevés, les portails ont retrouvé la mémoire des histoires fondatrices et la flèche disparue a même été réinventée pour pointer vers le ciel. C’était une belle victoire contre les évidences qui n’avaient que la force de leur fatalisme et contre tous les calculs qui ne peuvent mesurer les rêves !
Mais c’était plus. Le poète et l’architecte ont sauvé plus que des murs : ils ont réanimé la vieille dame endormie ; ils ont sauvé l’essence du vaisseau amarré aux bords de Seine ; ils ont donné chair à l’âme de Notre-Dame.
Parabole qui parle de revitalisation.
Parabole, maîtresse de vie lorsque l’inquiétude née de la lucidité nous saisit devant l’état des lieux de ce qui est notre maison, l’Église.
« Il est venu le temps des Cathédrales » chante Garrou et l’épopée inspirée du coup de gueule de Victor, devenue spectacle, a, à nouveau bouleversé les foules.
« Il est venu le temps de l’Église » devrait devenir notre détermination de croyants au 21e siècle.
Il est venu le temps de l’Église ! Église enracinée dans une Parole vivante, Église mobilisée pour vivre la révolution de l’Évangile, Église nourrie parce qu’elle reçoit.
Église de la Parole qui n’a que quelques mots à partager, quelques histoires à se raconter, la vie d’un prédicateur provincial à découvrir, une croix à adorer. Parce que c’est là, dans ces mots écoutés, dans cette histoire répétée, dans cette vie qui nous provoque, dans ce choix qui nous conduit au silence, c’est là et là seulement, que nous pouvons découvrir le visage de l’Indicible. C’est là dans nos mots balbutiants qui redisent ces vieux récits que nous trouvons le fondement de la Parole que nous osons dire : « À qui irions-nous ? Tu as les Paroles de la vie » !

L’Église garde ces paroles comme son héritage mais aussi comme sa responsabilité.
Elle conservera fidèlement quelques-uns des premiers mots émerveillés de la foi et elle transmettra l’Évangile qu’elle a reçu des premiers témoins.
Mots fragiles mais qui éveillent à ce qu’ils ont voulu faire découvrir de Dieu : Évangile de vie pour la vie de la foi.
Mais elle inventera aussi des mots nouveaux : la foi n’est pas une répétition : la foi n’est pas une répétition de dogmes appris ou canonisés et l’amour ne vit qu’à inventer des mots inouïs pour se dire.
Église de la Parole appelée à être parlante. Église laboratoire de la vie selon l’Évangile.
L’Église conservera dans sa mémoire et sa vie quelque chose de l’expérience des premiers témoins : l’apprentissage au discernement des valeurs de l’Évangile pour fonder une vie chrétienne qui passera toujours par les intuitions ferventes des premières communautés croyantes.
Mais l’Église sera aussi fidèle à ce que suscite la vie qui jamais ne peut être programmée : elle relèvera les défis de chaque temps et inventera les ajustements difficiles de l’Évangile aux défis de la réalité de chaque époque.
Église de la Parole parlante. Église de la vie convertie. Église de l’étonnement et de la prière, Église nourrie parce qu’elle reçoit, Épouse qui appelle : « Viens » !
Elle s’émerveillera devant le mystère révélé dans le visage du Sauveur mais elle se laissera prendre aussi au feu de l’Esprit qui fait toutes choses nouvelles.
Il fallait un poète qui réveille l’âme engloutie sous les pierres ; il fallait aussi un entrepreneur pour donner corps au cri d’alarme du visionnaire.
« Il est venu le temps de l’Église ». Pour que la tradition sur laquelle elle s’enracine soit transmission, pour que les inspirations de l’Évangile des Béatitudes qui sont son héritage et ses raisons de vivre soient inspirantes dans les débats de nos sociétés vieillissantes et incarnent l’éternelle nouveauté du Prophète de Nazareth, notre maître de sagesse, pour que le souffle du Ressuscité qui nous institue en peuple de prophètes puisse soulever la pate humaine de ce temps, il nous faudra des poètes et des bâtisseurs non pas seulement pour sauver une institution en soins palliatifs mais pour revitaliser un peuple debout.
« Il est venu le temps des Cathédrales de pierres vivantes ».
La nuit dramatique, la leçon des ténèbres,
15 avril 2019
La grâce du patrimoine

Quasimodo nous a faits vibrés. Avec sa voix grave et son accent témoin de l’universalité de la culture française… Il magnifiait Notre-Dame. Comme tant d’autres. Et si l’épopée de Victor Hugo devenue musicale nous touchait ce n’était sans doute pas son romantisme uniquement : elle mettait en scène un symbole.
« Notre-Dame de Paris » s’affichait en panneaux publicitaires. Pour nous séduire. Pour nous faire chanter.
Ce soir du 15 avril, « Notre-Dame de Paris » nous fait pleurer.
« Un morceau de notre histoire s’est envolé en fumée », le « hit-parade des monuments avec ses 12 millions de visiteurs, 50.000 par jour », le chef-d’œuvre absolu du gothique… »
Les qualificatifs ne justifient pas l’émotion qui a saisi Paris, la France, le monde la nuit d’avril 2019.
Il y a quelque chose de plus que le drame de la perte d’un monument emblématique – nous n’aurions pas ressenti la même émotion en apprenant l’incendie du Château de Versailles ou l’effondrement de la Tour Eiffel…, quelque chose d’indéfinissable qui nous étreint. Comme si c’était un morceau de nous-mêmes qui subissait cette violence. Comme si c’était une part de Notre-Dame qui était blessée.
Parce que Notre-Dame est plus que Notre-Dame. Parce qu’elle est de l’ordre du symbole.
Huit cents ans s’y concentrent – Saint Louis, Jeanne d’Arc, la Reine Margo, Napoléon, Victor Hugo ? Claudel, de Gaulle, et tant d’autres y ont lié leur nom -, deux siècles pour l’édifier, certes ; mais ces pierres vénérables sont plus que des pierres.

Le drame de Notre-Dame nous touche si profondément parce qu’elles matérialisent une certaine image de l’homme, du monde et symbolisent la part de nous-mêmes qui est plus que nous-mêmes et que nous ne finissons pas de chercher.
C’est la grâce – la beauté mais aussi le don – du patrimoine religieux : il est admirable et admiré à juste titre respectable et donc à respecter, parce qu’il « respire » et « transpire ». Il « respire » ce qui a motivé son existence : il a une âme. Les pierres de Notre-Dame sont plus que des pierres parce qu’elles portent l’empreinte de ce qui a mobilisé commanditaires et artisans : elles sont une construction de la foi. Elles sont un message.
Il « transpire » ce message qui, par lui, a traversé les siècles. Ce n’est pas seulement un monument à regarder, c’est un appel à accueillir. Le patrimoine religieux ne peut se comprendre dans une approche voyeuriste, il ne peut se livrer qu’en nous questionnant et en nous provoquant ; la perfection de sa beauté c’est l’appel qu’il lance : le contemplant il nous renvoie à l’image de nous-mêmes.
C’est la grâce du patrimoine religieux : nous donner comme une grâce les cicatrices de ce que l’histoire nous a livré, non pas des vestiges mais quelques traits précieusement conservés de la vie des croyants dont nous sommes les héritiers.
Non pas pour les admirer de l’extérieur mais pour nous questionner, nous bouleverser, nous provoquer.
Au-delà d’une approche documentaliste ou esthétique, il entrouvre la porte d’un Mystère et la pierre se fait lumière.
Invitation : la grâce du patrimoine
Station à l’église Sain-Séverin au cœur du Quartier Latin
En visitation

Elle courrait… Elle venait d’apprendre la nouvelle impensable : elle allait enfanter !
« Comment cela peut-il se faire « ? avait-elle répondu. « Fiat - Qu’il me soit fait selon ta parole » ! la parole de celui qui élève les humbles, la parole qui révèle sa fidélité à travers les âges.
Elle courait et elle, la visitée, court vers la vieille cousine de Judée. Comme si elle devait affermir son Fiat à la vieille épouse du prêtre gardien du Temple et de la fidélité d’Israël. C’est en embrassant la dernière témoin de la Première Alliance qu’elle pourra laisser chanter en elle le cantique des temps nouveaux et son Magnificat, en enlaçant Élisabeth devenue 1re témoin de l’accomplissement de ce qu’elle a espéré, signera enfin son « Fiat ». Il n’y a de foi que confortée dans la visitation de croyants en communion.

Elle courrait pour rendre visite et pour être visitée.
Nous sommes venus en visitation. Pour être visitée.
Nous sommes venus pour être les hôtes d’une longue lignée de témoins, pour être héritiers d’une longue histoire dont nous sommes les enfants. Nous ne sommes pas venus en touristes voyeuristes pour nous émerveiller de monuments remarquables mais à l’extérieur d’eux (et cela déjà justifierait notre démarche) ; nous sommes venus en pèlerins, en visitation, pour être embrassés par ces pierres qui transpirent la foi de ceux qui ont bâti ces édifices. Ce ne sont pas des monuments mais des témoins les reliques de croyants.
Nous sommes venus en pèlerin pour visiter les croyants qui sont les habitants de ces lieux et devenant les hôtes de Maurice de Sully du roi Louis XIII, de Violet Le Duc, nous espérons devenir des visités
Héritiers et hôtes, à travers le temps, nous formons un peuple.
En visitant la vieille maison de famille, nous redeviendrons un peu plus des héritiers. Le peuple des croyants.
Ce peuple s’annonce des lointains de l’histoire, il a pris rythme et souffle de la succession des générations, d’une communauté inlassablement tissée dans le temps par les épreuves et les espérances.
La voix du temps parle en lui, ce temps qui façonne l’identité d’un peuple avec son langage, ses habitudes, ses rites, cette longue expérience de vivre et de mourir qui est sa nourriture pour sa marche aujourd’hui, parfois son refuge, et qui sera sa trace pour ceux qui prendront la route demain.
Au plus profond de notre être-croyant il y a cet ensemble d’images, de symboles, de paroles et de silences qui nous ont façonnés, qui nous façonnent, qui assurent notre identité dans la durée en nous représentant à nous-mêmes une image de notre origine, une manière d’être au monde pour aujourd’hui, une volonté d’ouvrir les voies d’un projet pour demain.
Cette année concrète, ce cœur qui bat en nous, quelle voix l’appelle, quelle parole au bord du silence la suscite, quelle célébration la recrée, la renouvelle ? Où se recrée, s’identifie et reprend force l’âme de notre être croyant ?
Surgie des tombeaux de l’oubli se lève pour nous la mémoire essentielle des fondateurs, ceux qui sont devenus par le témoignage de leur expérience les soubassements de notre demeure intérieure.
Ce sont ces poètes épiques, ceux dont la parole consignée dans le Livre raconte la naissance de la communauté, sa geste initiale lors de l’esclavage et sa fulgurante rencontre au désert, son épopée au long des siècles. Il y a des prophètes consumés par leur œuvre de parole, il y a des poètes lyriques, chantres des Psaumes, des Cantiques des Cantiques ou de la Sagesse, ceux qui trouvèrent des mots pour prier et des mœurs pour vivre. Il y a pour nous les poètes de l’Évangile ceux qui entendirent proclamer le prophète des bords du lac. Il y a surtout cet homme lui-même, Jésus de Nazareth.
Et il y a encore, par-delà ces paroles fondatrices, celles, multiples, qui sont les échos démultipliés qui donnent voix à ce testament. Il y a la conscience vive d’être les enfants charges d’en poursuivre l’œuvre et d’en accomplir l’histoire.
Nous l’éprouvons chaque jour ! La visitation de notre foi est nourrie à l’écoute des poètes de la foi, des fondateurs du peuple croyant.
Se replonger dans les sources de sa fondation, c’est pour notre espérance retrouver la vigueur et la joie de la jeunesse.
Les quitter c’est souffrir et même risquer la mort.
Certes (on le dira) l’écoute des pères fondateurs des poètes de la foi n’est pas une visite au musée du passé mort. Mais dans le mémorial vivant des événements fondateurs, dans la célébration par l’assemblée du peuple d’une tradition rendue ainsi actuelle, dans la profession publique d’un avenir promis, nous recevons vie et endurance, nous revivifions notre être-croyant, nous renaissons.
Car le « Fiat – Qu’il me soit fait selon ta parole » de la foi ne s’affermit que dans le Magnificat d’une visitation.
Michel Teheux